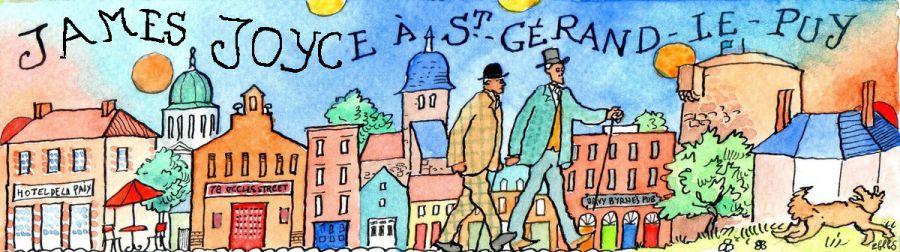— Quelle étude vous tient le plus à cœur, celle sur Ulysse ou celle sur Finnegans Wake ?
— C'est évidemment celle sur Finnegans Wake. Celle sur Ulysse, je me suis amusé à la mener sur la lancée du premier et pour y mettre quelques élucubrations personnelles auxquelles je tiens beaucoup (l'homme au mackintosh, les symboles), etc. Mes délires sur la Cabale et le Tarot m'ont amusé mais me gênent un peu maintenant !!
Mais c'est l'étude sur Finnegans Wake qui compte pour moi et dont je suis finalement assez fier. J'y ai accumulé une somme "d'indices" et de réflexions, synthétisé beaucoup de mes lectures sur ce roman, et apporté des éléments personnels qui me semblent nouveaux et pertinents (tant pis pour la modestie !). J'ai la prétention d'avoir vraiment découvert des choses importantes sur Finnegans Wake, à tel point que je songe à pondre un petit essai sur mes interprétations (hélas ! mon style est misérable et mon vocabulaire assez limité, pfff…).
— Quel est votre personnage préféré dans Ulysse ?
— C'est Léopold Bloom. J'allais dire : évidemment ; mais, apparemment, ça ne l'est pas pour tout le monde. Une jeune universitaire joycienne passionnée par Ulysse me dit n'avoir que pitié pour le misérable Bloom et admirer surtout l'artiste Stephen. La plupart des premiers lecteurs ont vu en Bloom une triste parodie du bel Ulysse grec (pour ne pas dire aryen). Cela me semble un contresens absolu ! Bloom EST Ulysse. Il partage avec le roi d'Ithaque le pacifisme, l'amour de sa famille, le désir d'échapper à la bêtise de ses contemporains (guerre, idolâtrie, xénophobie, crédulité sexuelle, etc.), la ruse, la gentillesse, la sensibilité — et j'en passe. Bloom est le véritable héros du roman de Joyce.
C'est d'ailleurs là que réside le sens même de l'œuvre : par la communion avec Bloom (une véritable trans-substantialisation !), l'artiste Stephen va découvrir la vraie sensibilité, judaïque, charnelle, sceptique, qui lui manquait tant. J'insiste : Bloom est l'un des héros les plus formidables de la littérature ! Il égale le Jésus des Évangiles qui, comme lui, ne fait que rappeler ces évidences dont personne ne veut, à savoir que ce qui compte plus que tout, c'est l'amour, la bonté, l'incrédulité, la douceur, la tolérance, la joie de vivre, etc.
— L'une des caractéristiques les plus marquantes du livre est son unité de temps. L'histoire se déroule sur une seule journée et le livre fait plus de mille pages en édition de poche. Pourquoi, selon vous, Joyce a-t-il choisi cette "restriction" temporelle, notamment par rapport à l'Odyssée d'Homère ?
— La “restriction temporelle” est un jeu, un exercice de style. Pourquoi faire durer cela sur plusieurs jours ? C'est plus drôle et intense sur un seul. Par exemple, une journée suffit pour passer en revue les fonctions corporelles ; voir Bloom aux toilettes tous les jours de la semaine n'apporterait rien de plus !…
— Comment définiriez-vous le travail d'écriture de Joyce et sa volonté de faire une œuvre “parfaite”, regroupant tous les styles littéraires ?
— Je ne pense pas que Joyce ait considéré le dernier roman ou la pièce sur lequel il travaillait comme un produit fini, isolé, autonome. Je pense qu'il considérait chaque œuvre comme une étape dans une démarche de toute une vie. Portrait de l'artiste en jeune homme annonce un transition vers autre chose. Les Exilés aussi. Ulysse également. Sans savoir à quoi il aboutirait, il avançait avec un but : échapper au cauchemar de l'histoire, à la langue morte qui nous aliène, par une nouvelle parole vivante. Ne pas oublier ses modèles absolus : la Bible et Dante.
Tout ça pour dire qu'Ulysse est un passage et que Finnegans Wake me semble l'aboutissement de ce passage. Si Joyce avait vécu plus longtemps, peut-être aurait-il été plus loin encore, mais ce n'est pas si sûr : car son dernier roman se termine par un adieu et un retour au silence, alors que les précédents offraient une fin "ouverte".
Donc — pour répondre enfin à votre question — je crois qu'avec Ulysse Joyce a tenté d'écrire le dernier roman réaliste en y mettant tous les styles romanesques existant à son époque. Une somme pour en finir avec une certaine histoire de la littérature et passer à autre chose. Cette “autre chose” est déjà à l'œuvre dans Ulysse : les néologismes, le monologue intérieur anarchique, les lapsus, etc. Il s'agit déjà de faire passer une parole vivante à travers le langage traditionnel sclérosé et épuisé. C'est une eucharistie ! Le verbe vivant passe dans le pain du texte et le transfigure (je donne l'impression d'être une vraie grenouille de bénitier, non ?).
— J'ai peur d'attaquer Finnegans Wake. Pouvez-vous me convaincre ?
— Ah ! Ah ! Finnegans Wake !! Comment convaincre ??? J'ai déjà essayé de convaincre un ami et même mon ex-directeur, qui tous deux appréciaient Ulysse. Ils sont sûrement persuadés dorénavant que je suis un pédant ou le comble du snobisme intellectuel. Finnegans Wake est un amphigouri illisible et hermétique, une impasse, une expérience d'avant-garde absurde et ratée, etc, etc. Tout le monde répète ça, sauf quelques universitaires dont les thèses pompeuses ne me prouvent pas du tout qu'ils aient vraiment apprécié le roman.
Selon Wittgenstein, les limites de notre langage sont les limites de notre monde. Alors comment multiplier, diversifier nos accès au monde sinon en agissant sur notre langage ? Chaque mot perdu est une sensation perdue, dit justement Sollers. Plus notre vocabulaire rétrécit et plus notre monde se rapetisse. Chaque mot est une terminaison nerveuse qui rend notre sensibilité plus subtile, plus vive. Alors, pour multiplier les sensations, multiplions les sens des mots et les mots mêmes. Essayons de les faire accoucher de toutes les richesses sémantiques dont ils sont porteurs. Créons-en de nouveaux en fusionnant, mélangeant, opposant et sabotant les anciens ! Finnegans Wake est un nouveau langage qui transcende complètement l'écriture traditionnelle où les mots sont instrumentalisés, outils morts mis au service d'un message à transmettre. La langue joycienne, au contraire, pullule de sens, et ses accidents produisent le sens à la surface même du texte, plutôt que de véhiculer un sens métaphysique qui serait au-delà du texte.
Tout ça, c'est bien gentil, mais si vous ne tombez pas immédiatement amoureux de cette écriture, ma démonstration ne servira à rien ! Car alors votre lecture sera forcée et vous abandonnerez au bout de deux pages ! La traduction de Ph. Lavergne se voit souvent reprochée d'être trop traduite (pas assez d'allitérations, de néologismes, de mots-valises, etc.). C'est vrai, mais c'est la seule complète et elle a tout de même beaucoup de qualités ! La traduction de deux chapitres par André du Bouchet (Gallimard) est plus “jolie”, plus musicale… mais difficile à trouver… La traduction “parfaite” est celle de Sollers et Heath, mais ils n'ont fait que cinq pages environ !
Que dire d'autre ? Cette écriture est un comble de sensualité, de tendresse, d'humour, d'émotion, de musicalité, de diversité, de jubilation, d'enfance et d'innocence ! C'est une caresse, que dis-je ? un bouquet de caresses, de douceur, d'érotisme, de compassion. C'est tendre, émouvant, grotesque, illuminant, vain, biblique, scatologique, puissant, dérisoire. C'est une musique, un souffle, un murmure, un chuchotement imperceptible et un brouhaha cacophonique assourdissant.
Finnegans Wake me semble l'œuvre annoncée par Nietzsche dans ses plus belles pages, quand il sent toutes les potentialités créatrices affleurer à la surface de la conscience transfigurée par la joie, ne demandant qu'à jaillir au grand soleil de midi en un bouquet de sensations, de chants, de couleurs, de rire, de larmes, pour étreindre le monde entier dans un OUI d'affirmation — oui à tout, au grandiose et au mesquin, à la force et à la fragilité, à la beauté et à la petitesse… Incipit Dionysos !
Et puis c'est un comble de perversité intellectuelle, s'appuyant sur la théologie catholique. Toutes les aliénations, les obsessions, les névroses, les fixations, les dévotions sont visitées, traversées, ironisées, retournées et annulées. La parole traverse tout de part en part, perce le monde, échappe à la mort et ressuscite en elle-même à chaque seconde ! Les constructions intellectuelles et spirituelles les plus importantes sont ramenées à quelques figures dérisoires et obscènes : tout tourne autour d'un cul ! Et Dieu dans tout ça ? Un trou !!!
Quiconque tient à la sécurité des fondements du langage, de la société, de la morale, de la religiosité collective, ne peut qu'être dérangé par Joyce comme par Picasso. L'un comme l'autre traversent la représentation, la révèle pour ce qu'elle est : un tissu de mensonges, une tapisserie d'illusions, un texte cacophonique de signes entremêlés illisibles ! L'un comme l'autre de ces deux démiurges recréent le monde de toute pièce avec ses propres éléments transfigurés. C'est une assomption par l'écriture… et une colossale plaisanterie !
Stephen sentait les potentialités infinies de la création artistique sous « l'arbrenciel d'étoiles lourd d'humides fruits bleunuit ». Finnegans Wake est l'explosion de ces fruits mûrs, éclaboussant le lecteur de jus sucré, de pulpe fraîche, promesse de fertilité, d'abondance, de bonheur ! Et tout cela sous l'œil de l'infini, le silence des étoiles au-dessus de notre agitation stupide (le cauchemar de l'histoire).
Sur la page d'accueil de mon site, vous trouverez un lien vers un enregistrement de Joyce pour un autre passage. Écoutez-le moduler sa voix sur tous les tons, tantôt pompeux, tantôt timide, enjoué, apeuré, amusé, attendri, fatigué et toujours jeune. Cette voix est la vie même, la seule vraie vie, celle qui peut traverser notre monde de mort sans s'y enchaîner. Elle vient de plus loin que lui et nous, elle passe par nous et nous éveille. Elle passe quelquefois dans la bouche d'un poète, quelquefois dans la notre, quand la douceur prend la place du langage bête et méchant quotidien. Elle est ce qu'il y a de plus vivant en nous. Elle survivra à tout… Écoute, ô Israël !
— Vous consacrez une large place aux influences intégrées dans Ulysse. Il est donc normal de rendre la pareille. Commençons par Godard. Le réalisateur, dans Pierrot le fou, fait dire à Belmondo : « J'ai trouvé une idée de roman : ne plus décrire la vie des gens mais seulement la vie, la vie toute seule ; ce qu'il y a entre les gens, l'espace, le son et les couleurs. Il faudrait arriver à ça. Joyce a essayé mais on doit pouvoir faire mieux. » Qu'en pensez-vous ?
— Je connais très peu Godard et je n'en pense pas grand-chose. Ulysse était le dernier mot du réalisme (je ne sais pas si L'on a fait mieux depuis), mais ce n'était pas que ça, c'était beaucoup plus riche et pervers. Joyce récupère et pervertit quasiment tous les modes du savoir (philo, religieux, mythique, hermétique, analogique, dialectique, scientifique, journalistique, etc.). En général, je doute des pouvoirs du cinéma à dire des choses importantes, ou tout au moins lucides, réalistes. L'image est subie, elle est inapte, me semble-t-il, à faire passer une parole vive à laquelle peut participer le spectateur ; c'est du domaine de la lecture. La peinture par exemple se lit, elle réclame un lecteur actif alors que l'image cinématographique se subit passivement. Ceci dit, je sors de voir Journal intime, du talentueux Nanni Morretti, qui contredit complètement ce que je viens d'écrire !!! Je crois que le réalisme au cinéma a un aspect reportage qui limite le réalisme à un compte rendu sociologique, mais je me trompe peut-être…
— John Houston a adapté Gens de Dublin. Est-ce qu'Ulysse est adaptable, selon vous ? Y a-t-il eu des tentatives ?
— Il y a une adaptation en cours en Irlande, je crois. À mon avis, l'adaptation d'un roman est toujours ratée ! Les adaptations me font grincer des dents. Un livre gêne fondamentalement, et c'est pourquoi on cherche à détruire sa force subversive en en faisant du spectacle, c'est-à-dire du connu, du convenu, de digérable ! Adapter Ulysse me semble un comble de prétentions. Ou alors qu'on fasse un film de 24 heures ! Encore un fois, je doute de l'image cinématographique. À côté de l'écriture, elle ne pèse plus rien. Vous me prenez peut-être pour un fanatique mais c'est faux : j'aime bien le cinéma, c'est distrayant, mais je ne vois aucune œuvre capable de rivaliser avec la littérature !
— Dans votre étude sur Ulysse, vous proposez une théorie sur “l'identité de l'homme au mackintosh”. D'où vous vient cette hypothèse ?
— C'est la théorie selon laquelle l'homme au mackintosh est Dieu le Père, c'est-à-dire le Créateur, donc pour le roman l'Auteur, donc Joyce lui-même, et qu'en conséquence Bloom est le Fils et Stephen le Saint-Esprit … C'EST MA THÉORIE !!! — et, en plus, je la trouve particulièrement juste !!! Voilà une petite découverte dont je suis fier, parce qu'elle remet en question la lecture théologique du roman (qui n'intéresse pas grand monde, hélas !). Beaucoup ont assimilé Bloom à Jésus et, souvent, la paternité, l'un des grands thèmes du roman, est mise entre Bloom et Stephen, celui-ci trouvant un père spirituel en celui-là. Mais c'est faux : ils sont frères ! ils communient à la fin du livre, « chacun contemplant l'autre dans le miroir charnel de son “le sienpaslesien visage semblable” ». Et donc Molly est Marie.
Le point typographique qui manque à la fin de l'avant dernier chapitre du livre [il s'agit d'un point mis pour unique réponse à la dernière question de l'avant dernière partie d'Ulysse, celle avant le monologue de Molly] est-il typique de la traduction française ou est-ce un véritable oubli des éditeurs ?
J'ai découvert cette histoire de point manquant dans Détours et retours, de Jean Louis Giovannangeli (Presses Universitaires de Lille, 1990). Je n'en ai jamais entendu parler ailleurs. J'ai feuilleté une édition anglaise d'Ulysse et pas vu le moindre point. Je suppose qu'il ne l'a pas inventé mais je suis un peu dubitatif…
— À quels autres auteurs consacreriez-vous un site ?
— Je n'ai créé mon site que pour trier, accumuler, synthétiser, faire partager et échanger des idées, des indices, des bricoles sur Joyce. Je n'ai rien à dire sur mes autres auteurs favoris, alors que je prétends avoir des choses à transmettre sur Joyce…
Michel Chassaing a découvert Joyce à travers Finnegans Wake pendant l'été 1995 dans une traduction de Phillipe Sollers et S. Heath (in Tel Quel 49/50) — illumination immédiate ! Il poursuit avec Ulysse. Convaincu qu'il n'existe aucune introduction française valable aux romans de Joyce, hormis celle, datée, de Jean Paris, il crée, en 1999, un site — http://riverrun.free.fr — qui propose (en PDF) quatre études se rapportant aux deux romans. Il s'intéresse plus particulièrement à deux aspects fondamentaux de l'œuvre de Joyce — l'obscénité et la théologie —, que Philippe Sollers, le premier, avait abordés. Après trois ans de présence sur la Toile, il s'avoue aujourd'hui déçu par l'absence de manifestation d'autres "investigateurs" de l'œuvre de Joyce (avis aux amateurs !). Entretien avec William Pierre, en juin 2001.
Portrait d'un artiste en deux études sur la Toile
Merci de votre visite !
Mise à jour le
26 MAI 2023


© Bernard Deubelbeiss